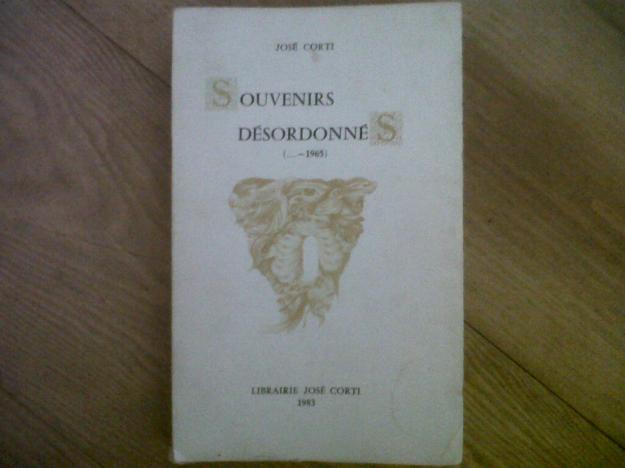Bientôt 6h que l’avion s’était posé.
Elle s’était rangée, comme chaque nouvel arrivant fraichement débarqué, dans cette queue interminable qui menait à la vérification des passeports. Et ne pas filmer photographier, rester en file bien droite, ne pas utiliser de téléphone ni d’appareil électronique, ne pas parler non plus. Se voir dispatcher par un quelconque employé de l’aéroport (ils se ressemblent tous, costume sombre, teint gris, regard inquisiteur) vers l’un ou l’autre des postes de contrôle, en petites grappes humaines impersonnelles, visages à peine frôlés, effacés, une même apparence, hommes ou femmes, traits et couleurs dilués dans la masse, anonymat le plus complet. Tout d’abord, on ne vous demande rien, on vous toise, puis on vous parle d’un ton autoritaire ne souffrant pas de répartie, ne reste qu’à se taire, suivre la file, les flèches, le chemin désigné et baisser les yeux, accepter, le temps de passer ce foutu guichet. Elle fixait ses pieds avec le plus de concentration qu’il lui était possible, tant désobéir la démangeait, tant d’ordre la dérangeait, lui donnait envie de fuir ou de hurler, d’éclater de rire ou de tout casser. Mais il fallait se taire, ne pas être remarquée. Formulaire d’exemption de visa dûment rempli, pas de rature ni d’hésitation, signature claire et propre, parfaite, déclaration de douane irréprochable, humour proscrit, ici on est hermétique à toute forme de seconde degré, il faut savoir bien répondre, pas de drogue pas d’alcool, ni de maladie honteuse et autre joyeuseté, non merci, je suis là pour visiter votre si beau pays, je ne compte pas rester longtemps, deux semaines à peine, non rien à déclarer, regard baissé, paupières mi closes et surtout cacher la flamme qui crépite à l’intérieur. Puis se plier au rituel empreintes-scans-photo, se taire malgré les fourmillements qui électrisent ses muscles. Il prit son temps, le policier, pour feuilleter son passeport, page après page, un sourcil tendu en circonflexe, comme s’il apprenait par cœur chaque inscription. Il faut dire qu’il y en avait des tampons, presque à chaque page et autant de pays visités depuis ces derniers mois. Il scrutait encore et encore, à la recherche d’un indice, d’une erreur, un petit os à se mettre sous la dent, relevant régulièrement son sourcil pour lui jeter un œil qui voulait tout voir sonder deviner, avec mépris en prime, toi ma cocotte, je te vois venir, pourquoi tant de voyages et pourquoi atterrir ici en ces temps d’alerte maximale…
Elle, restait calme en apparence, caressant dans sa paume le petit objet qui s’y trouvait. Mais le policier ne voulait pas lâcher…
Le verdict tomba : il lui faudrait attendre ailleurs, juste à côté avant de pouvoir récupérer ses bagages, vérifications complémentaires, détails à éclaircir… Un gentil homme en costume d’ailleurs l’y accompagnait, poignée ferme autour de son bras, marche autoritaire et cadencée, impossible d’y échapper. La voilà, assise, dans une pièce étroite sans fenêtre avec de nombreux compagnons d’infortune venus des quatre coins du globe. Voyageurs seuls ou en groupe, certains avec enfants, beaucoup de gens de couleurs et quelques blancs dont elle. Une inquiétude lourde, oppressante teintait l’atmosphère. Chaleur étouffante, odeur de transpiration, doigts se nouant se dénouant, piétinements. Elle, se cala au fond de son confortable siège en plastique et ferma les yeux. Mal de crâne en préparation. Dans sa paume, tout contre elle, la douceur de l’objet. Sa chaleur… Comme une vibration. Les secondes coulaient et elle les laisser glisser. Les secondes s’enfuyaient et elle se sentait mieux. Ailleurs. A ce point de son voyage, plus rien ne pouvait lui arriver, se disait-elle. Elle en était certaine. Tant de frontières passées, de kilomètres parcourus. Elle avait vu tant de merveilles et de misère, ouvert les yeux sur des mers vouées à disparaître, lumière pâle du levant sur le lissé d’un mince océan. Elle avait traversé des villes riches et bouillonnantes, où l’électricité n’avais pas pu tirer ses fils, les habitants l’avaient accueillis et aidé sans la moindre contrepartie, elle avait partagé les tables d’inconnus, des heures à veiller et discuter, à des milles d’ici, chaque ville chaque visage chaque main serrée restait ancrée dans sa mémoire, chaque mot tatoué dans sa chair… Elle avait traversé des métropoles de béton et d’argent où la solitude plombait l’air et les cœurs, où la terre étouffait et souffrait sous de lourdes et toxiques vapeurs. Ces odeurs, amères, acides, âcres elle les sentait encore, vivaces, intactes. Sous ses paupières avenues, boulevards, rues défilaient, piétions pressés, vies savamment paramétrées. Destins scellés.
Rien n’avait pu l’arrêter.

Combien d’heures s’écoulèrent ? Quatre ou cinq, encore ? Sans boire, ni pouvoir manger. Peu importe. La guerre des nerfs l’avait quitté.
Elle savait.
Avant même qu’il n’entre dans la pièce, elle savait.
Avant même qu’il ne lui tende ses papiers, l’air hargneux du chien qui est obligé de laisser sa proie filer, elle savait.
Tout comme elle était certaine qu’il ne la lâcherait pas d’une semelle, tant qu’elle resterait sur son territoire. Il serait là, dans l’ombre prêt à bondir. Et c’est la gorge qu’il viserait.

Dans un crissement sec, les portes automatiques s’ouvrirent devant elle laissant place au scintillement d’immeubles et de tours vitrées. Un brusque coup de vent vint fouetter son visage, chassant au loin tout l’épuisement et la fatigue des dernières heures… Instinctivement, elle se mit à serrer un peu plus fort l’objet au fond de sa poche, cet objet qui l’avait guidé jusqu’ici. Une ville nouvelle et inconnue s’offrait à elle. Il y avait tant à faire. Et plus une minute à perdre.
Texte et photos: Louise_imagine
Ana NB et Pierre Ménard
Christophe Sanchez et Christopher Selac
Samuel Dixneuf et Benoît Vincent
Camille Philibert-Rossignol et Chez Jeanne
Urbain trop urbain et Microtokyo
Christine Jeanney et Anna Vittet
Isabelle Pariente-Butterlin et Olivier Lavoisy
François Bon et Jacques Bon
L’autre-je et Joye
Nicolas Bleusher et Brigitte Célérier